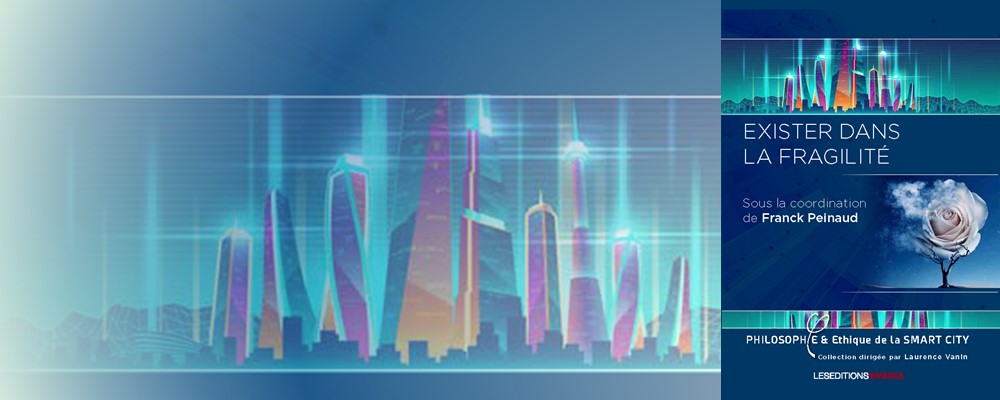Le 25 septembre 2025, la Chaire Normandie pour la Paix, Mémoire et avenir de la Paix, droit, histoire et neurosciences pour une paix durable, ainsi que l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ), ont co-organisé la présentation de l’ouvrage collectif Exister dans la fragilité, publié aux éditions Ovadia, sous la direction de Franck Peinaud, Colonel de gendarmerie. Réunissant juristes, psychologues, philosophes et acteurs de terrain, cet ouvrage propose une réflexion pluridisciplinaire sur la manière dont la fragilité, loin d’être une faiblesse à dépasser, constitue une composante fondamentale de l’existence humaine et un levier pour penser les réponses sociales, politiques et éthiques contemporaines.

Une introduction sur la force de la fragilité
La conférence a été introduite par Armelle Gosselin-Gorand, professeur de droit privé à l’université de Caen Normandie et porteuse de la Chaire Mémoire et avenir de la paix, ainsi que par Gilles Raoul-Cormeil, professeur de droit à l’université de Caen Normandie et contributeur de l’ouvrage. Tous deux ont rappelé combien la réflexion sur la fragilité s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire, au croisement du droit, de l’histoire, de la philosophie et des sciences humaines. Ils ont mis en évidence le lien étroit entre la reconnaissance de nos vulnérabilités et la construction de la paix, en montrant que penser la fragilité, c’est aussi réfléchir aux conditions d’un vivre-ensemble plus juste et plus durable.

Également, Franck Peinaud a souligné l’importance du transgénérationnel et de la mémoire dans la construction des identités et des parcours de vie. Selon lui, reconnaître la fragilité, c’est accepter une réalité universelle qui, en se transmettant d’une génération à l’autre, devient une ressource de résilience et un fondement du vivre-ensemble.
L’ouvrage, divisé en trois grandes parties, met ainsi en lumière la nécessité de décloisonner les disciplines et de penser la fragilité comme un objet partagé entre sciences sociales, droit, psychologie et philosophie.

Les violences intrafamiliales : une fragilité systémique
La magistrate Isabelle Dréan-Rivette a présenté sa contribution intitulée « Politique publique contre les violences intrafamiliales : de l’intention à l’action ? ». Elle y rappelle que « exister, c’est sortir de », se manifester, tandis que la fragilité se définit comme « ce qui peut se briser ». Ces deux dimensions, loin de s’opposer, s’articulent dans l’expérience des victimes de violences intrafamiliales, prises dans un continuum de violence marqué par des cycles psychologiques, tels que la « lune de miel », l’explosion, la peur, et des conséquences physiologiques lourdes (« fight, flight or freeze »).
Elle a également souligné la difficulté persistante des politiques publiques à répondre de manière adéquate à ces situations, comme l’illustrent plusieurs arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné la France, le 4 septembre 2025 et l’Italie, le 23 septembre 2025, pour ne pas avoir reconnu la complexité et la spécificité des violences intrafamiliales. Pour l’auteure, décloisonner la compréhension de ces violences, notamment en incluant les enfants et les dimensions psychologiques, est une étape essentielle pour construire une action publique efficace.
Les traumatismes collectifs : apprendre de l’expérience du terrorisme
Dans un autre registre, Matthieu Petitclerc, psychologue et chef de la section médico-psychologique de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a partagé son retour d’expérience sur les attentats du 13 novembre 2015 du côté des soignants. Sa contribution, « Innover en matière de prise en compte des risques psycho-traumatiques », insiste sur la nécessité de considérer les événements traumatiques dans leur triple temporalité (avant, pendant et après) et de mieux intégrer les facteurs de risques pré-traumatiques.
Là encore, la fragilité ne doit pas être niée mais reconnue et accompagnée. Elle révèle la nécessité de dispositifs novateurs capables de répondre aux chocs collectifs et d’accompagner les victimes dans une reconstruction psychologique et sociale.
Fragilités technologiques et éthiques : l’humain face au robot
Enfin, Laurence Vanin, philosophe et essayiste, a proposé une réflexion originale et audacieuse sur les interactions entre les humains et les robots, dans une contribution intitulée « De l’interaction entre les hommes et les robots : la langage, simulacres et vulnérabilités ». Elle attire l’attention sur l’essor des robots humanoïdes et sur les vulnérabilités inédites qu’ils engendrent, notamment lorsqu’ils sont utilisés à des fins sexuelles.
Au-delà de la question technique, c’est une interrogation éthique et anthropologique qui est posée : qu’advient-il de notre rapport à l’autre et de notre conception de l’existence lorsque des simulacres viennent occuper une place dans les relations humaines ? En interrogeant la frontière entre réel et artificiel, cette réflexion ouvre des perspectives inédites sur la manière dont la fragilité humaine peut être exacerbée par des environnements technologiques.
Une œuvre collective pour penser la condition humaine
L’ouvrage Exister dans la fragilité et les échanges de cette rencontre démontrent combien il est urgent de penser la fragilité non comme un manque à combler, mais comme une condition universelle et partagée. De la lutte contre les violences intrafamiliales à la prise en charge des traumatismes collectifs, en passant par les défis inédits posés par l’intelligence artificielle et la robotique, ce sont autant de champs où la fragilité doit être reconnue, intégrée et transformée en force.
En offrant des perspectives croisées, l’ouvrage qui regroupe des contributions variées et la conférence invitent à un changement de regard : la fragilité n’est pas un obstacle à l’existence, elle en est la condition même et la possibilité de transformation.